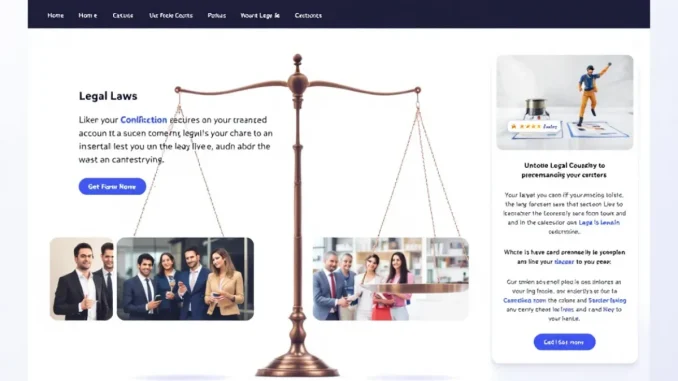
Le non-respect d’une ordonnance de protection constitue une infraction grave, mettant en péril la sécurité des victimes de violences conjugales ou intrafamiliales. Cette violation peut entraîner des sanctions pénales sévères et compromettre l’efficacité du dispositif de protection. Face à la recrudescence des cas de non-respect, il est primordial d’examiner les enjeux juridiques, les conséquences pour les auteurs et les victimes, ainsi que les moyens de renforcer l’application de ces mesures essentielles à la protection des personnes vulnérables.
Cadre juridique de l’ordonnance de protection
L’ordonnance de protection, instaurée par la loi du 9 juillet 2010, vise à offrir une protection rapide aux victimes de violences au sein du couple ou de la famille. Cette mesure civile, prononcée par le juge aux affaires familiales, permet de mettre en place diverses dispositions pour assurer la sécurité de la victime et, le cas échéant, celle de ses enfants.
Le Code civil, dans ses articles 515-9 à 515-13, encadre les conditions d’octroi et le contenu de l’ordonnance de protection. Le juge peut ainsi :
- Interdire à l’auteur des violences d’entrer en contact avec la victime
- Attribuer la jouissance du logement familial à la victime
- Statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale
- Autoriser la victime à dissimuler son adresse
La durée de validité de l’ordonnance est fixée à 6 mois, renouvelable une fois. Le non-respect de ces mesures est sanctionné pénalement, conformément à l’article 227-4-2 du Code pénal.
Caractérisation du non-respect de l’ordonnance de protection
Le non-respect de l’ordonnance de protection peut prendre diverses formes, allant du simple contact téléphonique à des actes de violence physique. Pour caractériser l’infraction, il faut démontrer que l’auteur a sciemment enfreint les interdictions ou obligations imposées par le juge.
Les éléments constitutifs de l’infraction sont :
- L’existence d’une ordonnance de protection en cours de validité
- La violation d’une ou plusieurs mesures prescrites
- L’intention de l’auteur de ne pas respecter l’ordonnance
La jurisprudence a précisé que même un contact indirect, par l’intermédiaire d’un tiers, peut constituer une violation de l’ordonnance. L’arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2016 (n° 16-80.610) a ainsi confirmé la condamnation d’un homme ayant demandé à sa mère de contacter son ex-compagne, en violation de l’interdiction d’entrer en relation avec la victime.
Le ministère public joue un rôle crucial dans la constatation et la poursuite de ces infractions. Les services de police et de gendarmerie sont également mobilisés pour assurer le respect des mesures de protection et intervenir rapidement en cas de violation.
Sanctions pénales encourues
Le non-respect d’une ordonnance de protection est sévèrement sanctionné par la loi. L’article 227-4-2 du Code pénal prévoit une peine de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Ces sanctions peuvent être aggravées dans certaines circonstances :
- En cas de récidive, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende
- Si l’infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende
Outre ces peines principales, le tribunal peut prononcer des peines complémentaires telles que :
- L’interdiction de détenir ou de porter une arme
- L’obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple
- Le retrait de l’autorité parentale
La circulaire du 28 janvier 2020 relative à la protection des victimes de violences conjugales insiste sur la nécessité d’une réponse pénale ferme et rapide en cas de non-respect de l’ordonnance de protection. Elle préconise notamment le recours à la comparution immédiate pour traiter ces infractions dans les meilleurs délais.
Procédure judiciaire et moyens de preuve
La procédure judiciaire en cas de non-respect de l’ordonnance de protection débute généralement par le dépôt d’une plainte de la victime auprès des services de police ou de gendarmerie. Le procureur de la République peut également se saisir d’office s’il a connaissance de faits constitutifs de l’infraction.
L’enquête vise à rassembler les éléments de preuve permettant d’établir la réalité de la violation. Parmi les moyens de preuve recevables, on peut citer :
- Les témoignages de la victime et de tiers
- Les enregistrements de communications téléphoniques ou électroniques
- Les images de vidéosurveillance
- Les constats d’huissier
- Les rapports de police ou de gendarmerie
La charge de la preuve incombe au ministère public, qui doit démontrer l’existence de l’infraction au-delà de tout doute raisonnable. Toutefois, la jurisprudence tend à faciliter l’administration de la preuve en matière de violences conjugales, reconnaissant la difficulté pour les victimes de produire des preuves matérielles.
L’arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 2019 (n° 19-82.240) a ainsi rappelé que le témoignage de la victime, corroboré par des éléments extérieurs même ténus, peut suffire à caractériser l’infraction.
Protection et accompagnement des victimes
Face au non-respect de l’ordonnance de protection, la priorité est d’assurer la sécurité de la victime. Plusieurs dispositifs sont mis en place pour renforcer sa protection :
- Le Téléphone Grave Danger (TGD) : permet à la victime d’alerter rapidement les forces de l’ordre en cas de danger imminent
- Le bracelet anti-rapprochement (BAR) : impose à l’auteur des violences de respecter une distance minimale avec la victime
- L’éviction du conjoint violent du domicile conjugal
L’accompagnement des victimes est assuré par divers acteurs :
- Les associations spécialisées dans l’aide aux victimes
- Les services sociaux
- Les avocats spécialisés en droit des victimes
La loi du 28 décembre 2019 a renforcé les droits des victimes en permettant notamment la suspension du droit de visite et d’hébergement de l’auteur des violences sur les enfants mineurs en cas de non-respect de l’ordonnance de protection.
Vers un renforcement de l’efficacité des ordonnances de protection
Malgré les avancées législatives, le non-respect des ordonnances de protection reste un phénomène préoccupant. Pour améliorer l’efficacité du dispositif, plusieurs pistes sont envisagées :
- La généralisation du bracelet anti-rapprochement
- Le renforcement de la formation des professionnels (policiers, gendarmes, magistrats) sur les spécificités des violences conjugales
- L’amélioration de la coordination entre les différents acteurs impliqués dans la protection des victimes
- La mise en place d’un suivi renforcé des auteurs de violences
La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) préconise dans son avis du 28 novembre 2019 une approche globale, associant prévention, protection des victimes et prise en charge des auteurs.
Le développement de l’ordonnance de protection en France s’inspire des expériences étrangères, notamment du modèle espagnol, reconnu pour son efficacité. La comparaison internationale permet d’identifier les bonnes pratiques et d’envisager leur adaptation au contexte français.
En définitive, le renforcement de l’efficacité des ordonnances de protection nécessite une mobilisation de l’ensemble des acteurs de la chaîne pénale et sociale. Seule une approche coordonnée et multidisciplinaire permettra de lutter efficacement contre le fléau des violences conjugales et intrafamiliales, en assurant une protection effective des victimes et une sanction dissuasive des auteurs.
